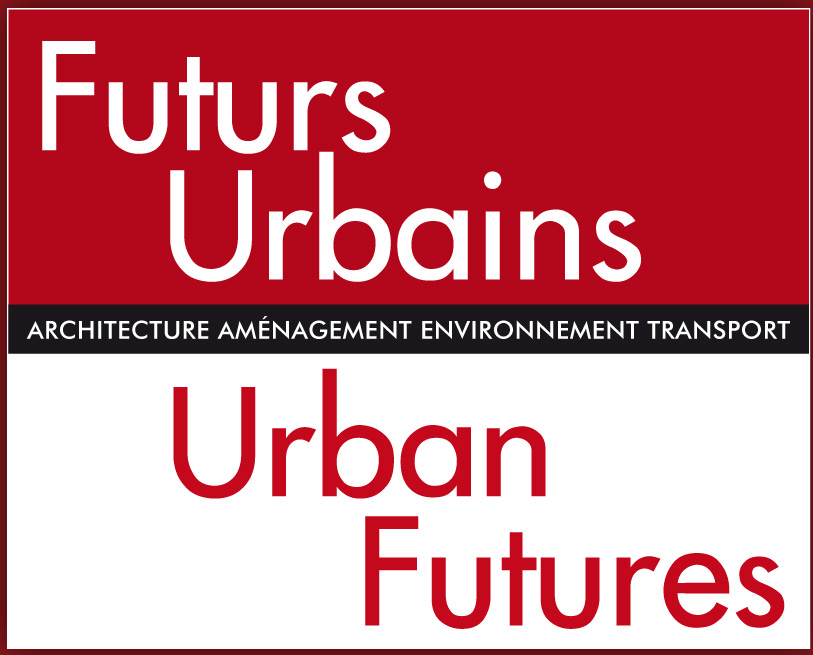Présentation du projet
Le groupe transversal « Mobilités urbaines pédestres » (MUP) est en partie organisé autour de projets de recherche-action avec des collectivités territoriales publiques françaises. Il s’agit de travailler de concert avec ces acteurs pour identifier les connaissances nécessaires sur les conditions de marche en ville et sur les déterminants, tant techniques que sociaux et politiques, de l’action publique dans ce domaine.
Le groupe s’attache à développer la notion d’infrastructure pédestre en observant que les activités de marcheurs ne sont pas réductibles aux déplacements piétons et sont difficiles à canaliser dans les infrastructures linéaires. Ces « tuyaux » sont poreux et les marcheurs vont d’une infrastructure à une autre par des points de passage formels ou informels et déconseillés (ou non-considérés comme les traversées d’îlots ou d’espaces verts). Or ces infrastructures dépendent de règlements et d’acteurs différents : en ce qui concerne la voirie, ces derniers se coordonnent pour faciliter et sécuriser la circulation des véhicules, pas celle des piétons ; en ce qui concerne les infrastructures hors-voirie, il n’existe pas encore de coordination. Toute une réflexion est à mettre en place pour redéfinir ce qu’est une infrastructure pédestre, sur les indicateurs ou mesures à analyser et la façon dont les acteurs urbains doivent se coordonner pour agir sur des sites relevant de plusieurs compétences (Hubert, J.-P., Monnet, J., Scapino, J. Infrastructure pédestre : une notion nouvelle pour repenser l’espace public, in Les mobilités décarbonées : un défi global, Bron : Cerema, 2021.
Ces réflexions amènent à des enjeux d’innovations théoriques et méthodologiques en cours de développement parle Groupe Transversal sur l’observation des marcheurs :
- Innovations théoriques sur le renouvellement de la notion d’infrastructure en y intégrant des éléments absents de la conceptualisation (et de la conception) des infrastructures urbaines et de transport.
- Diagnostic des besoins, décision et conception des aménagements : en conséquence de cette réflexion, le mode de décision et de conception des aménagements destinés à la marche n’a pas à suivre les mêmes procédures descendantes et techniciennes que celles utilisées pour les infrastructures routières. Or les trottoirs font partie de ces infrastructures et ils sont donc généralement conçus avec elles.
- Contributions théoriques à la réflexion sur la notion de « maîtrise d’usage ». Contributions qui se traduisent dans la dimension méthodologique dans les démarches participatives, pour analyser les besoins (budget participatif, notamment), les procédures de co-conception des aménagements. L’essor des démarches participatives – en se focalisant sur l'exemple de la Stratégie Paris Piéton – a été étudié et présenté dans un article (Demailly K. et al.. Quels impacts de la marche sur le « vivre » et le « faire » la ville contemporaine ?, Pollution atmosphérique, Climat, Santé et Société, 2018).
Le projet INFRAPED
Dans ce cadre général, le groupe MUP a développé entre 2019 et 2023 le projet « Infrastructure pédestre » (Infraped) avec l’administration des routes départementales du Val de Marne, en région parisienne. Le Conseil Départemental souhaite transformer sa voirie routière en « espaces publics à vivre » qui permettraient le développement des déplacements en vélo et à pied, favoriseraient les activités de proximité et contribueraient à l’inclusion sociale.
Dans cette perspective, notre but est d’aider à construire une capacité de diagnostic de la voirie qui associe l’identification de ses dimensions matérielles les plus significatives pour la marche et l’analyse des pratiques pédestres et des publics les plus sensibles à une transformation de l’infrastructure.
Après une première phase consacrée à la conceptualisation de l’infrastructure pédestre, la deuxième phase du projet a porté sur deux terrains d’expérimentation contrastés pour appliquer des méthodes qualitatives (observations, entretiens destinés à caractériser les interactions entre les usagers et leur environnement de marche) et des méthodes de comptage basées sur des enregistrements des flux piétons en différents points - trottoirs et traversées - et moments de la journée et de la semaine. Cette phase du projet a été réalisée dans le cadre du postdoc de Julie Scapino, ethnologue, supervisé par J.Monnet.
L’enquête de terrain cherchait à d’identifier ce à quoi les marcheurs, dans leur diversité et leur corporéité, sont « sensibles » sur une infrastructure pédestre (sensibilités négatives et positives). Les interactions entre marcheurs et infrastructure pédestre étant multidimensionnelles, l’observation s’est focalisée sur les interactions entre les corps des marcheurs et les éléments physiques de l’infrastructure, fixes et mobiles. Les sites, protocoles d’observations et résultats sont consignés dans le rapport. Les premiers résultats montrent l’importance de concevoir les espaces piétons en fonction d’une combinaison complexe de facteurs. Le fonctionnement global de la rue dépend du volume global de passants et de l’insécurité représentée par les véhicules (particulièrement intenses aux heures de pointe), ainsi que de la diversité interne des comportements pédestres, elle-même liée aux horaires, motifs de déplacement et profils sociodémographiques des usagers.
Le confort recherché par les marcheurs sur une infrastructure pédestre n’est pas uniquement corporel. Une part de confort répond à des critères d’ordre sociaux, notamment quant à la bonne distance entre son corps et celui des autres, qu’il s’agisse de la plus grande distance possible vis-à-vis d’inconnus ou au contraire de la plus petite distance avec les proches. En outre, si l’aménagement doit être accueillant pour les personnes en difficulté pour se déplacer, il peut intégrer des éléments hétérogènes exploitables par tout le monde pour faire une pause à l’écart des flux, ou par les plus valides pour contourner les obstacles. En effet, observer les marcheurs montre qu’ils sont ingénieux pour exploiter les interstices, les élargissements ponctuels, les décrochés. Du fait de l’importante plasticité des piétons, les interventions peuvent être pensés à des échelles diverses.
L’enjeu de la troisième phase est de compléter l’analyse et la spécification de ces « espaces publics à vivre » en tant que systèmes. Nous faisons l’hypothèse qu’il est possible de les caractériser par un nombre limité d’indicateurs du confort des piétons, complétant des mesures de comptage et des observations de terrain plus sommaires. La voie choisie a été de produire ces indicateurs à partir de simulations informatiques, afin qu’il soit possible de comparer des options d’aménagement différentes à l’état de projet. Cette phase a été réalisée dans le cadre du postdoc de Laura C. Echeverri, informaticienne, supervisée par Jean-Michel Auberlet et Jean-Paul Hubert.
Partenariat avec le Club des villes et territoires cyclables et marchables (CVTCM)
Le groupe MUP et le CVTCM collaborent depuis 2023 dans un projet de « recherche-action participative » dont la finalité est d’analyser les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent (a) faire un diagnostic des conditions de marche en ville et (b) s’engager dans le développement de celle-ci. Le projet consiste en une enquête quantitative et qualitative réalisée auprès de toutes les collectivités adhérentes du CVTCM.
La première phase s’appuie sur la diffusion d’un questionnaire pour répertorier les éléments nécessaires à un diagnostic, portant tant sur l’environnement de la collectivité (morphologie, infrastructures de transport, peuplement, présence et répartition des équipements et des services aux habitants etc.) que sur l’organisation de ses actions réalisées ou envisagées en ce qui concerne la marche. Les résultats du questionnaire permettront d’établir une typologie de situations.
Dans une deuxième phase, nous mènerons des entretiens qualitatifs avec les acteurs locaux sur les conditions dans lesquelles émergent les actions en faveur de la marche, et les difficultés ou opportunités qu’elles rencontrent. Après ces deux phases focalisées sur des collectivités pionnières dans le développement des mobilités actives, nous chercherons à élargir l’enquête à un panel représentatif d’une plus grande diversité de situations locales. Nous pourrons ainsi mieux évaluer les différentes conditions de diffusion et de développement des politiques de la marche en ville et, plus généralement, en agglomération.